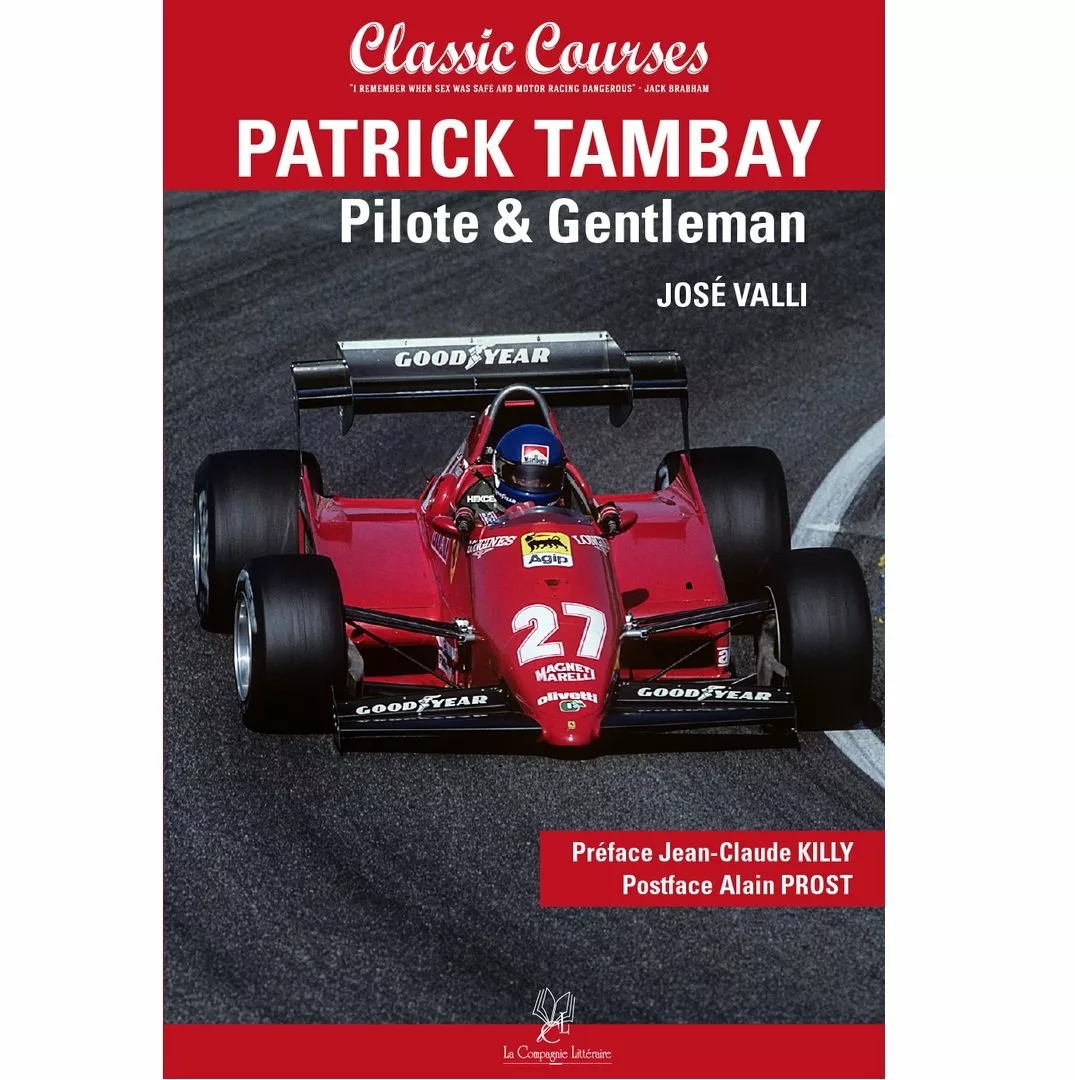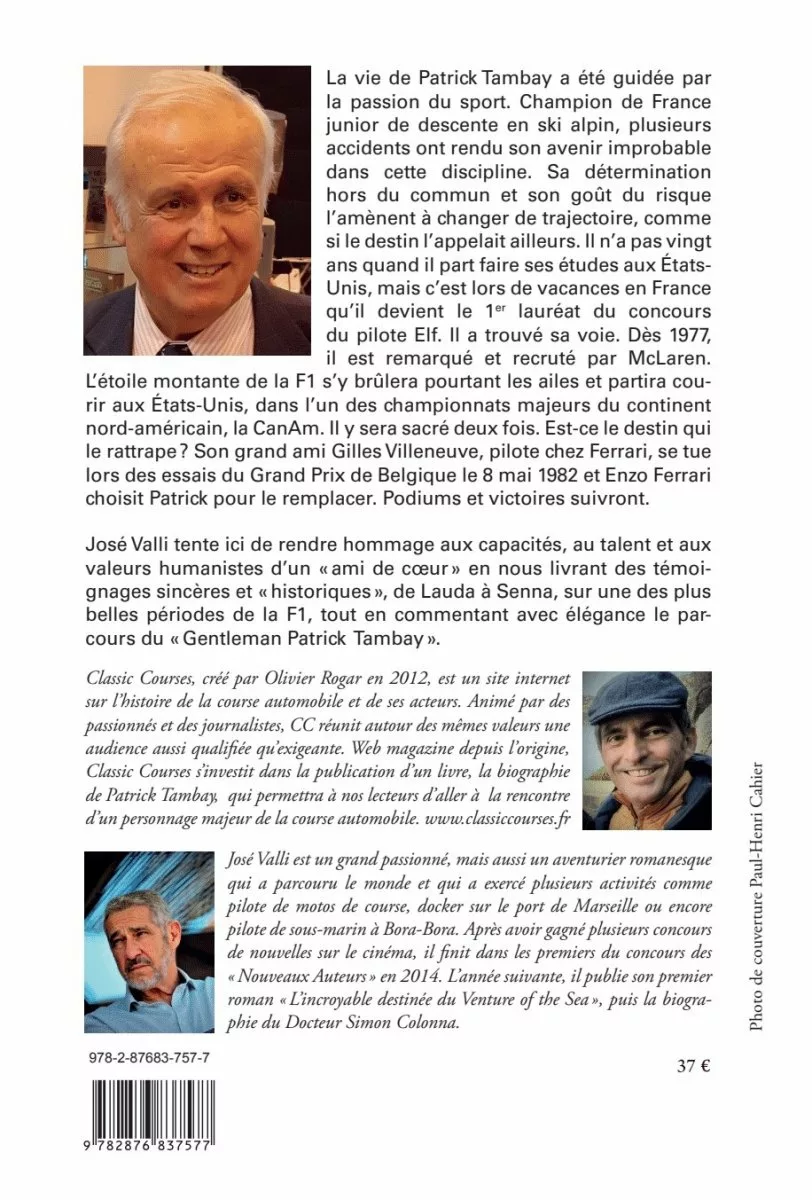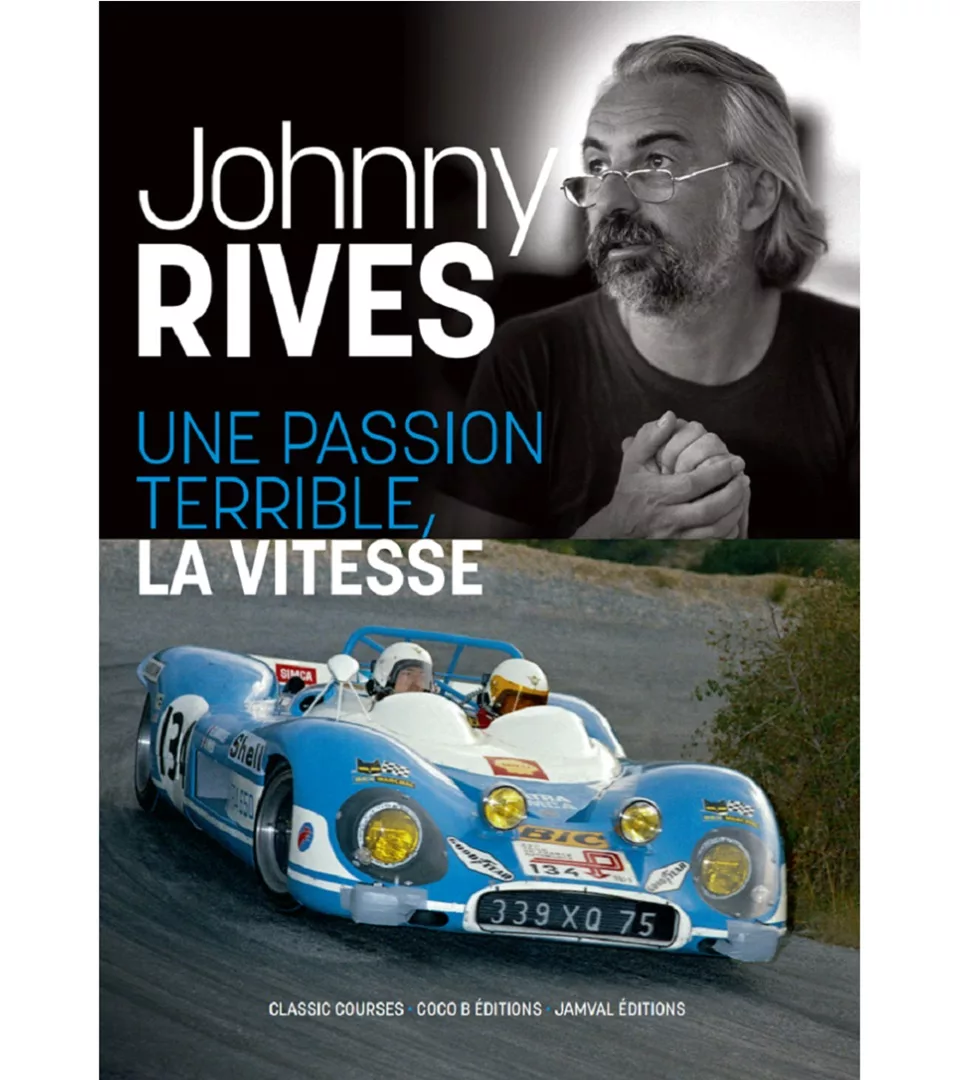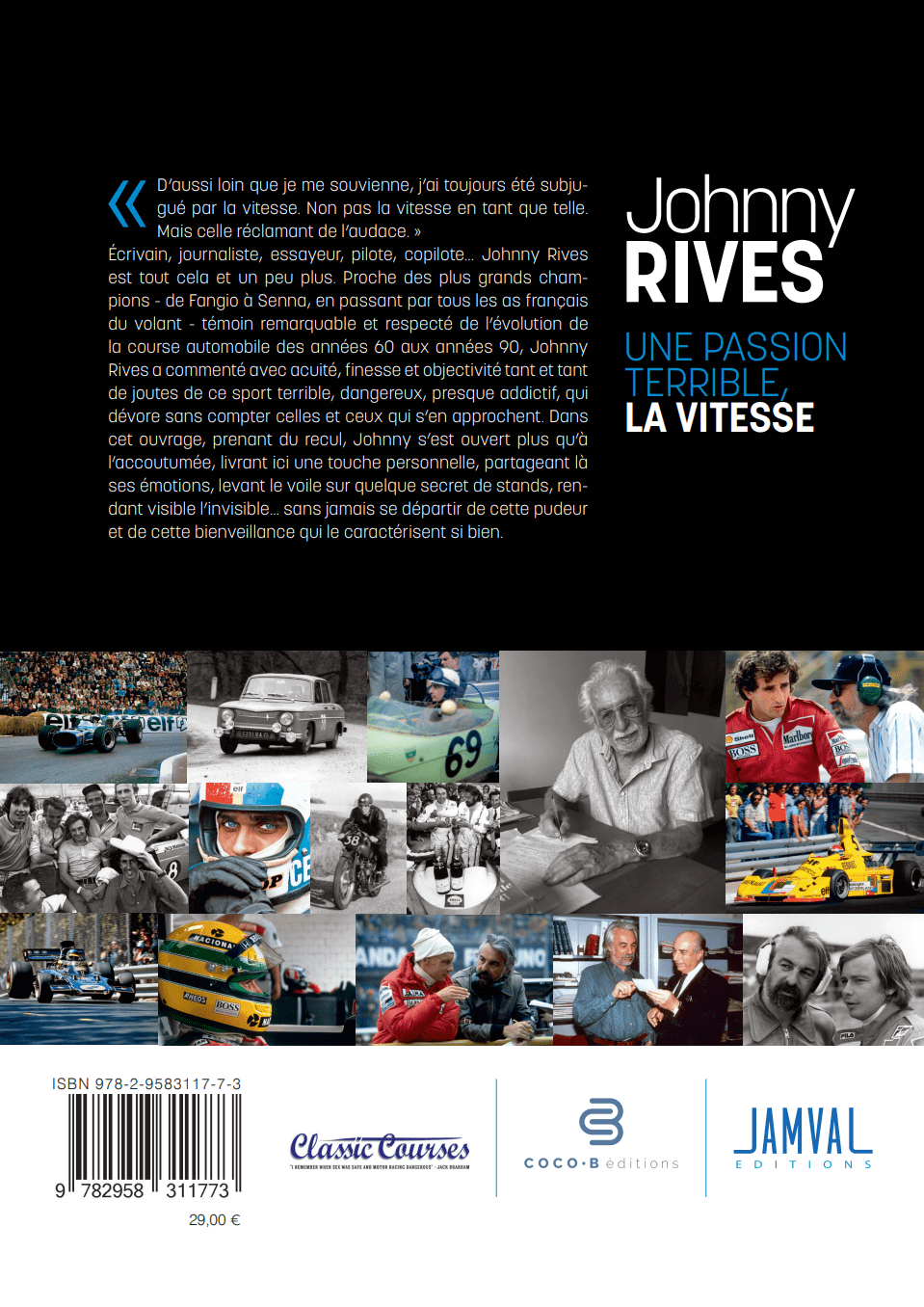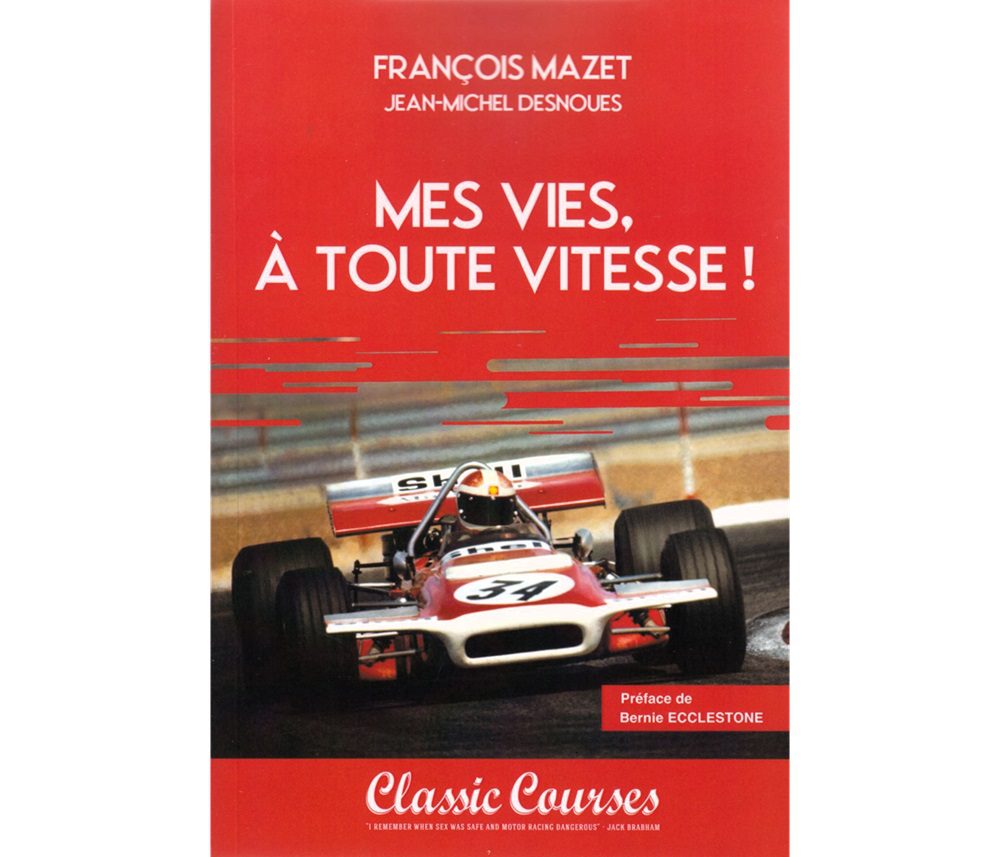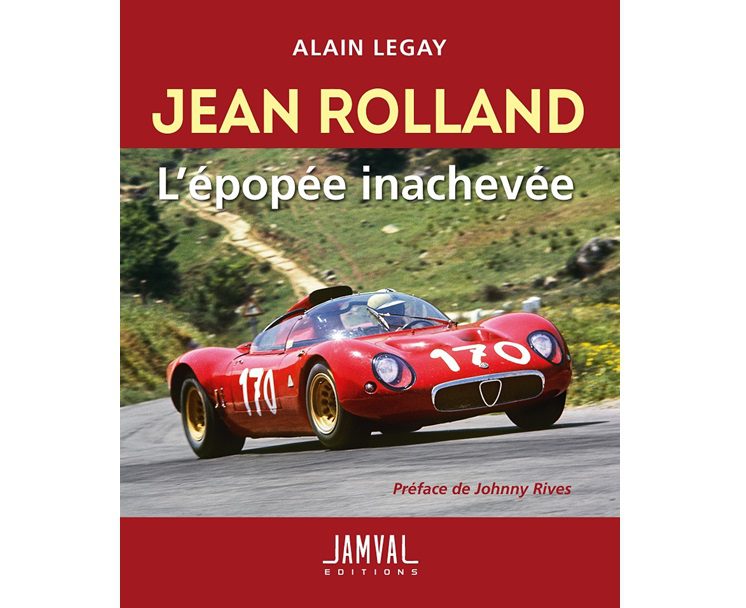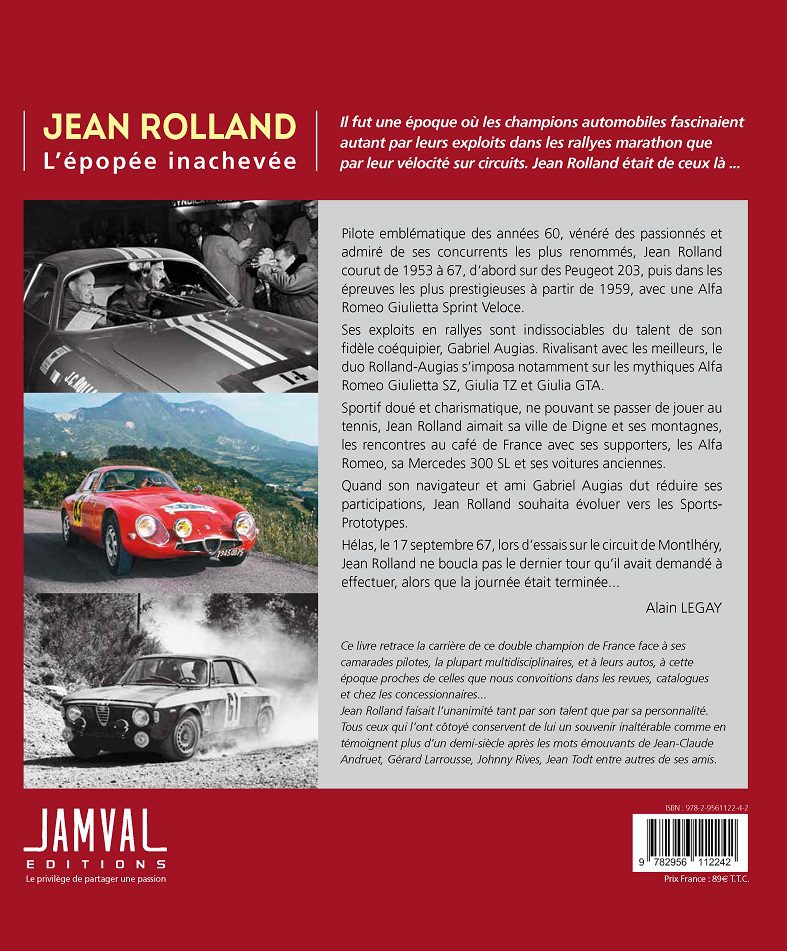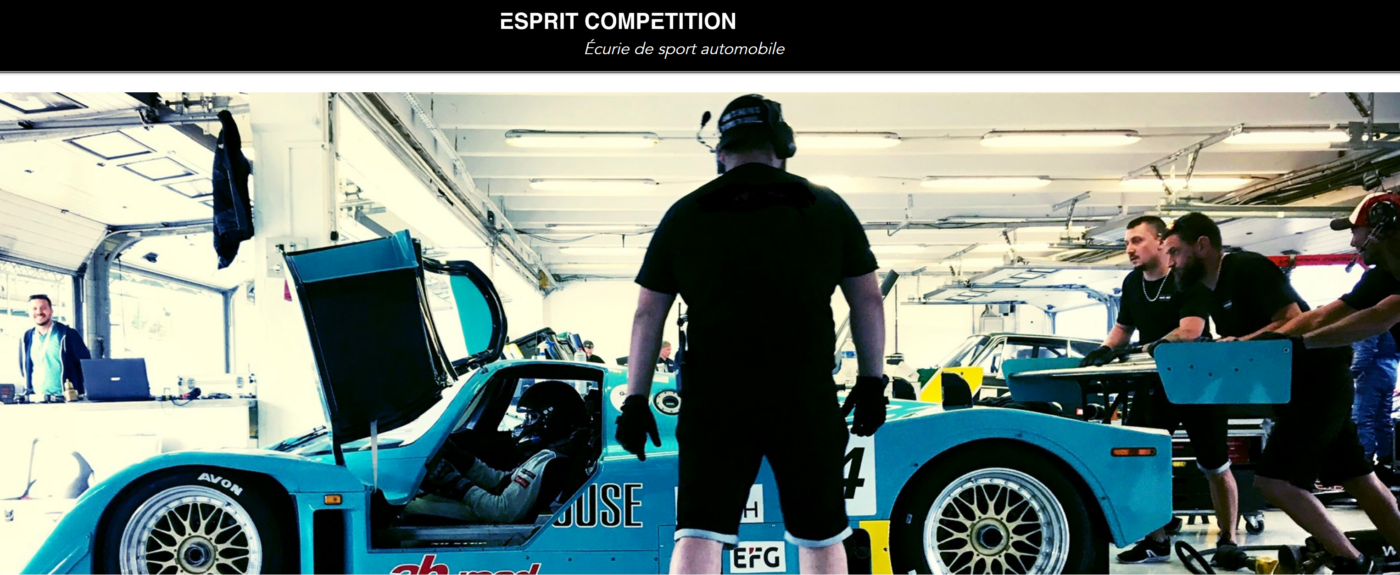Au matin du 11 juin 1972, entre Mulsanne et Indianapolis, une Lola jaune s’envolait dans la forêt bordant la piste. Ainsi disparaissait à 42 ans Joakim Bonnier, au crépuscule d’une longue carrière de pilote.
Olivier Favre
Riche de plus de 600 courses en vingt ans, sa carrière faisait le lien entre les années 50 et 70. Joakim Bonnier était un pilote sûr à l’expérience incomparable, mais il était aussi bien plus que cela. En guise d’hommage à l’occasion des 50 ans de sa disparition, revenons sur les multiples facettes de ce personnage protéiforme.
Jo Bonnier, le businessman
Rejeton d’une grande famille suédoise détentrice d’un empire industriel dans ce que l’on n’appelait pas encore les médias (presse, édition), Joakim Bonnier était certain, dès sa naissance en 1930, d’être toujours à l’abri du besoin. Mais, atteint par le virus de la course, il choisit sa propre voie. Les gains de son commerce de voitures lui permettent de financer ses débuts sur les pistes. Tout au long de sa carrière, il saura ne jamais perdre de vue que la course est aussi un business et qu’il n’est pas interdit d’en tirer profit.
Ainsi, par exemple, lorsqu’il entre chez Rob Walker en 1963, Bonnier comprend vite le bénéfice personnel qu’il peut tirer de sa position de président de la GPDA (Grand Prix Drivers Association). En effet, celle-ci lui donne un surcroît d’autorité pour négocier les primes de départ du team auprès des organisateurs. Aussi convient-il avec son boss qu’il s’en chargerait désormais, pour autant que 50 % de ces sommes lui reviennent !

Plus tard, Bonnier deviendra un véritable « businessman-driver » : pièces (importation des clous pour pneus hivernaux Kengrip rebaptisés Bongrip), boîtes de vitesses (concession Hewland), châssis (représentant Lola pour l’Europe continentale), etc … Indubitablement, Bonnier sait mener sa barque dans le business du sport auto. Car ce ne sont certainement pas ses résultats, en chute constante au cours des années soixante (en F1 en tout cas), qui lui assurent son train de vie, tout à fait enviable. D’autant moins que les pilotes, même les grandes vedettes, sont à l’époque loin de gagner les sommes de leurs successeurs des années 70 et 80.
Jo Bonnier, l’esthète
C’est Bonnier qui le premier, bien avant Stewart et Rindt, s’installe en Suisse, pour y trouver un climat fiscal plus tempéré. Il lance ainsi une tendance appelée à un grand succès chez les pilotes (et bien d’autres sportifs et célébrités). A La Grange, sa grande maison d’Arzier-Le Muids, sur les bords du lac Léman, il se montre un hôte prévenant. Tout autant que par le maître de maison, les invités y sont charmés par sa femme, Marianne, et ses deux garçons, Jonas et Kim, blonds, polis et multilingues.
Ces invités sont issus du sport auto bien sûr, mais aussi de bien d’autres milieux. Car, dans sa conversation, Bonnier aborde avec autorité divers sujets n’ayant rien à voir avec le sport automobile. L’art notamment. Il collectionne les œuvres d’art et détient des parts dans une galerie à Lausanne. D’ailleurs, si l’on excepte quelques trophées et la McLaren qu’il a accrochée dans son salon quelques mois avant sa mort, sa maison, toujours impeccable, aurait pu être celle de n’importe quel esthète aisé et de bon goût. Comme le résume Jackie Stewart, « he lived his life in great style ».

Jo Bonnier, l’homme impassible
« Jocke » (son surnom suédois) avait reçu une parfaite éducation dans un milieu où l’on ne s’épanchait sans doute pas facilement. Et il avait étudié dans les meilleures écoles où la discipline n’était certainement pas un vain mot. Puis il avait fait son service militaire dans la marine suédoise. Ce contexte de jeunesse corseté avait façonné une personnalité, qui pouvait paraître froide et distante. De fait, Bonnier en imposait avec son maintien quasi militaire et l’extrême maîtrise de ses émotions (1). Certains le trouvaient même arrogant. D’autant qu’il s’exprimait sans détours et cette franchise pouvait heurter. Mais selon ceux qui le connaissaient bien, il fallait plutôt y voir de la timidité. Car, dans l’intimité, il « se lâchait » et pouvait se montrer chaleureux et faire preuve d’humour. Avec ses amis proches, tel Graham Hill, mais aussi avec certains de ses collaborateurs.

Jo Bonnier, le pilote
Remarqué par Maserati, puis par BRM, il décroche la première victoire en F1 de la marque de Bourne (GP des Pays-Bas 1959). Puis il se taille un beau palmarès sur Porsche au début des années 60. Notamment à la Targa Florio où il gagne auprès des Siciliens le surnom de « Barbita » (le barbu).
Malgré ces résultats plus qu’honorables, « JoBo » n’est alors pas considéré comme un tout grand, que ce soit par ses pairs ou par les journalistes. On le dit rapide et sûr, certes. Mais peut-être trop prudent. Surtout à partir de 1963, quand il semble avoir perdu ce qui fait la différence entre un participant et un vainqueur en puissance. Sans doute y a-t-il plusieurs raisons à cela : la perte de son volant d’usine chez Porsche bien sûr ; mais aussi peut-être son mariage et la naissance de ses fils. Voire la mort de son ami von Trips, qui l’a beaucoup ébranlé. Mais son recul progressif vers le fond des grilles de départ est « compensé » par sa présidence du GPDA, qui lui donne une autre dimension et une nouvelle légitimité.

Jo Bonnier, l’apôtre de la sécurité
Lorsque la GPDA est créée à Monaco en 1961, Bonnier en devient vice-président sans l’avoir voulu. Mais deux ans plus tard il succède à Moss à la présidence et s’investit pleinement dans son rôle. Le fait est qu’il lui convient parfaitement : avec ce polyglotte (il parle 5 ou 6 langues en plus du suédois), élégant, distingué et doté d’un charisme certain, les revendications des pilotes ont forcément plus de poids. Et elles en ont besoin, tant ceux-ci sont à l’époque peu considérés !
Evidemment, il ne se fait pas que des amis parmi les organisateurs en exigeant que l’on prenne enfin au sérieux la sécurité des pilotes et des spectateurs. Certes, personne n’est dupe, ces exigences sont d’abord celles de Jackie Stewart, du moins après l’accident de ce dernier à Spa en 1966. Mais c’est Bonnier qui, inlassablement, monte au créneau et affronte les critiques, les rebuffades, avec tact et diplomatie. Bel hommage s’il en est, à sa mort, plusieurs pilotes reconnaîtront leur dette à son égard.

La course de trop
Les courses d’endurance lui réussissaient, mais il n’aimait pas Le Mans. Il avait disputé 12 fois les 24 heures entre 1957 et 1970, mais uniquement parce que c’était dans son contrat. Pour lui, cela faisait partie du job. Mais il s’agissait plus de préserver la voiture que d’aller vite et ça n’avait pas d’intérêt pour un pilote de Grand Prix. En outre, il trouvait cette course excessivement dangereuse, du fait des grandes différences de vitesse entre les voitures et du mélange entre professionnels du volant et simples amateurs.

Les deux Lola jaunes avaient fière allure au départ de cette édition 72. Mais le sponsoring des fromages suisses ayant été trouvé en dernière minute, la préparation des voitures avait eu lieu dans l’urgence et, de plus, JoBo était sur tous les fronts en tant que patron d’écurie. Au sein de son équipe, tous les témoignages concordent sur ce week-end manceau : qu’il s’agisse de son équipier Gérard Larrousse, de Heini Mader qui préparait ses moteurs ou du journaliste et photographe Jeff Hutchinson embauché en extra pour cette course, tous l’ont dit nerveux, fatigué et sans doute pas dans les meilleures dispositions pour disputer une épreuve de 24 heures.
Mais il aimait toujours la course et depuis le début de la saison cette Lola avait dominé les Alfa et démontré un beau potentiel face aux Ferrari. Il voulait sans doute voir concrètement ce qu’elle pouvait donner face aux Matra. En outre, son compatriote et protégé Reine Wisell était indisponible (2) et il lui manquait donc un pilote. Après un beau début de course, la Lola n°8 avait été considérablement retardée durant la nuit. Mais au petit matin JoBo attaquait fort. Pour le plaisir et, peut-être, pour signer un honorifique record du tour (3). Si l’on en croit Vic Elford, témoin de l’accident, c’est une tragique erreur de jugement qui lui coûta la vie entre Mulsanne et Indianapolis.

NOTES :
(1) Illustration du self-control de Bonnier, rapportée par Rob Walker lorsque ce dernier lui annonça fin 1965 qu’il n’engagerait plus qu’une seule voiture la saison suivante et qu’elle serait pour Jo Siffert : « Il a dû y avoir un silence plus long que d’habitude, mais il n’a quasiment pas changé d’expression ».
(2) Wisell s’était cassé un doigt deux semaines avant le Mans, à Oulton Park lors de la Gold Cup. Disparu il y a quelques semaines, le Suédois au casque vert était le protégé de JoBo, qu’il considérait comme « son meilleur ami, presque comme un grand frère ». Si la carrière de Wisell marqua le pas après 1972, la disparition de Bonnier n’y est sans doute pas étrangère.
(3) Record du tour qui appartenait déjà à cette même Lola n°8. C’est son équipier Gijs van Lennep, qui l’avait signé.