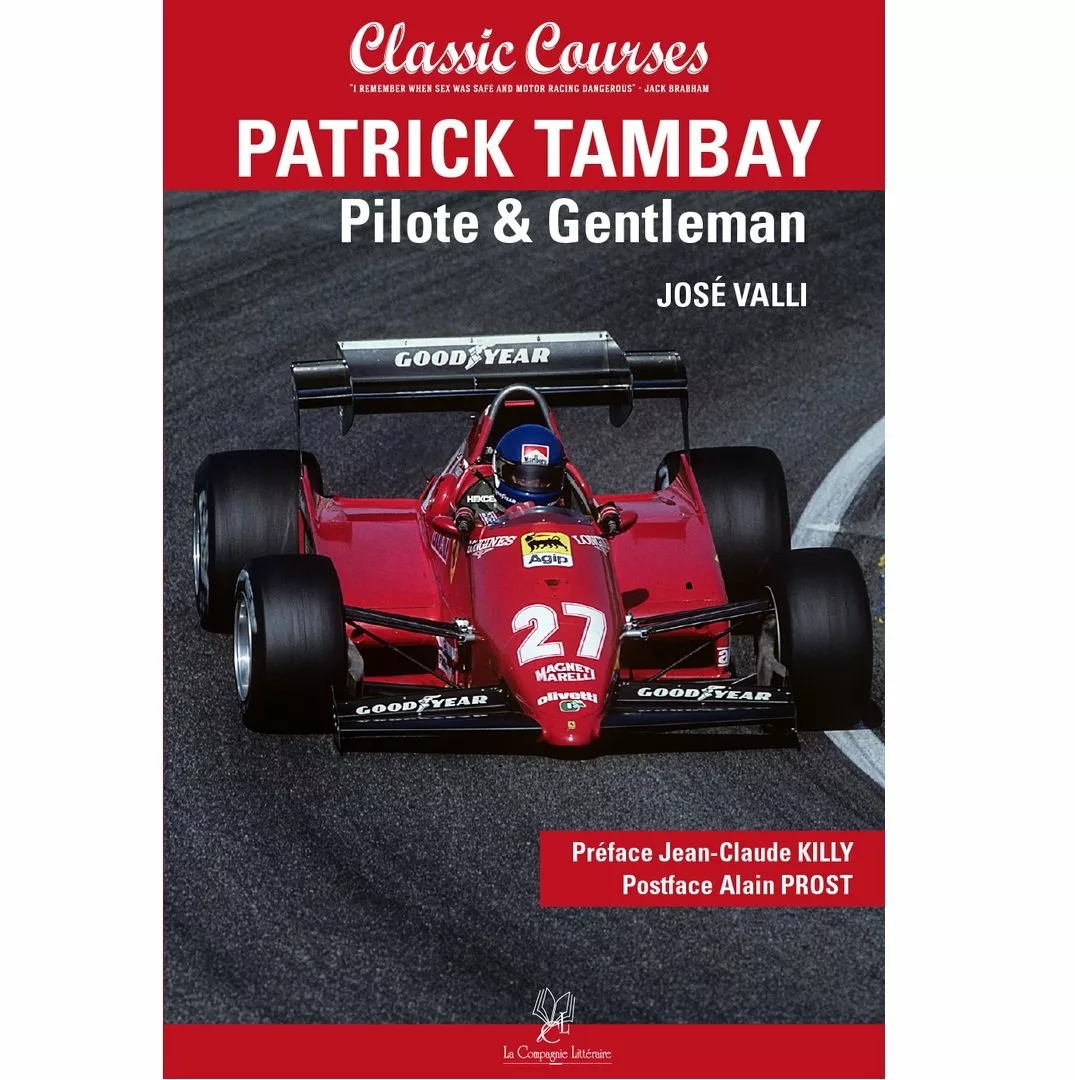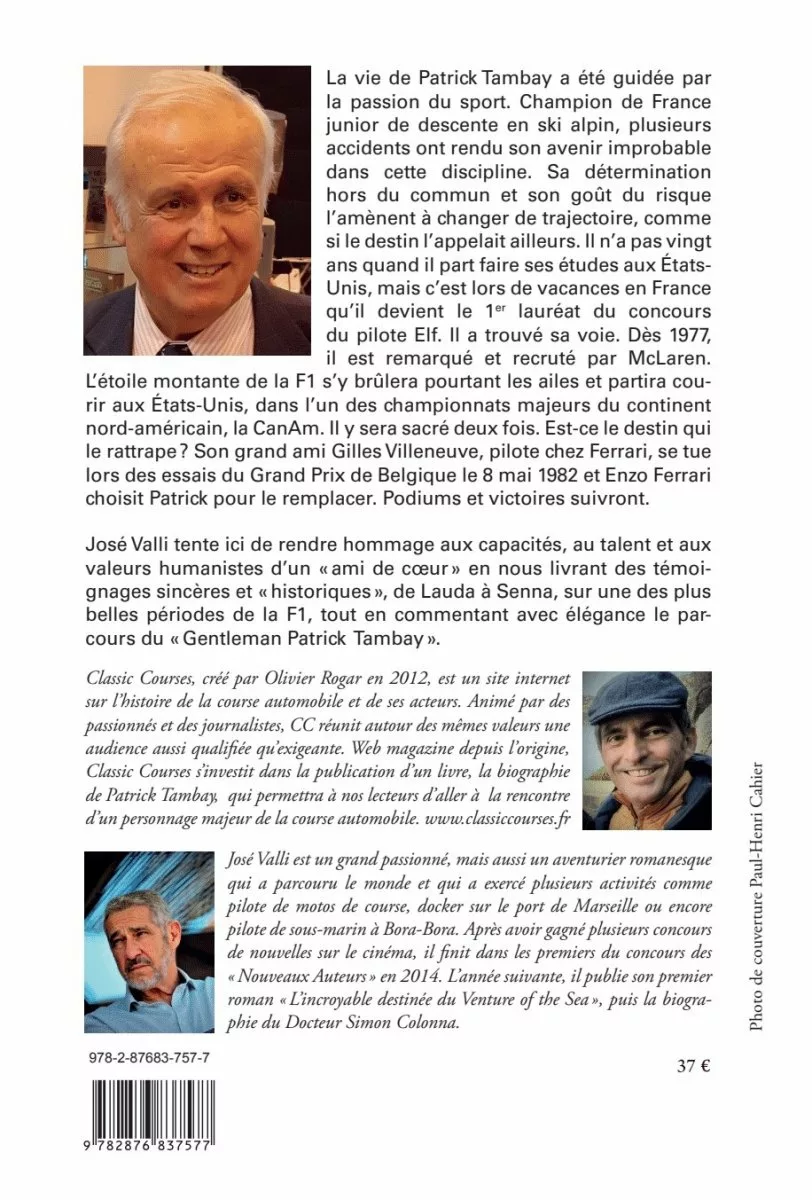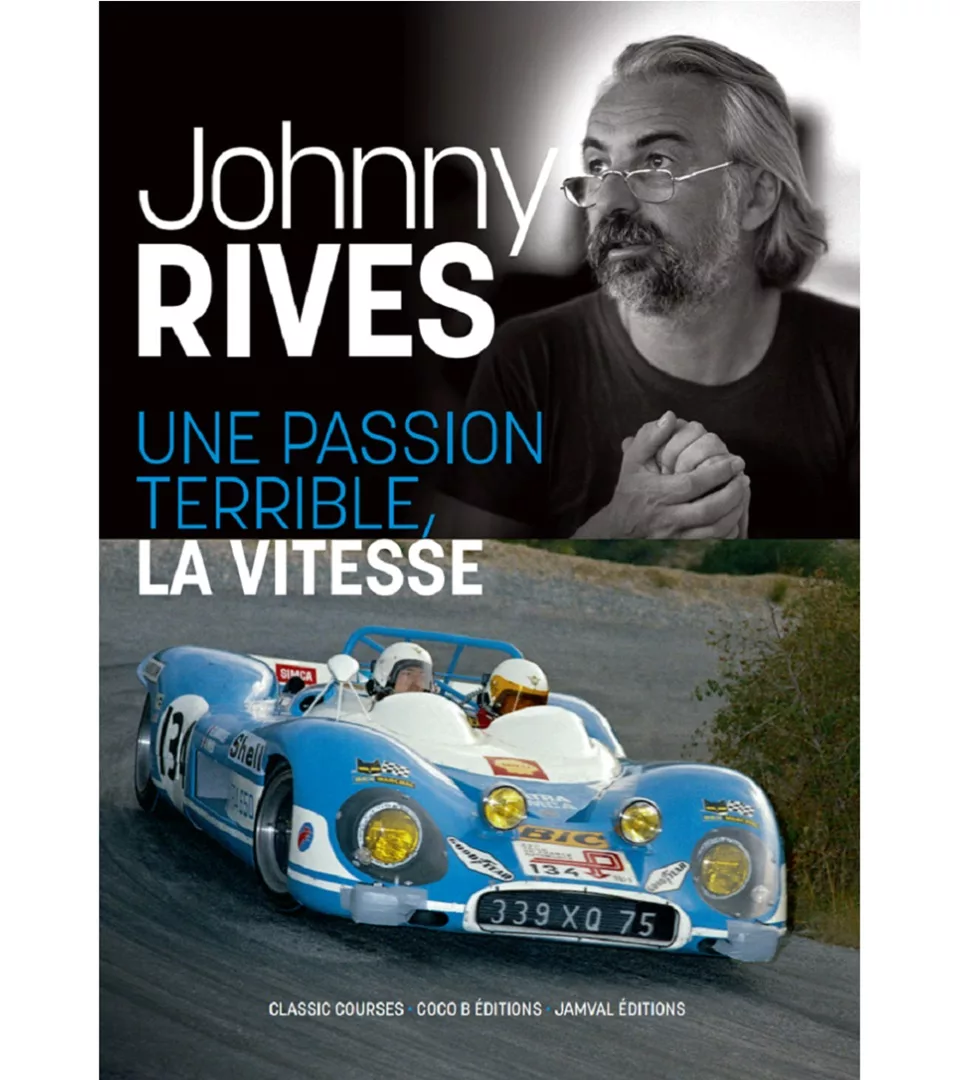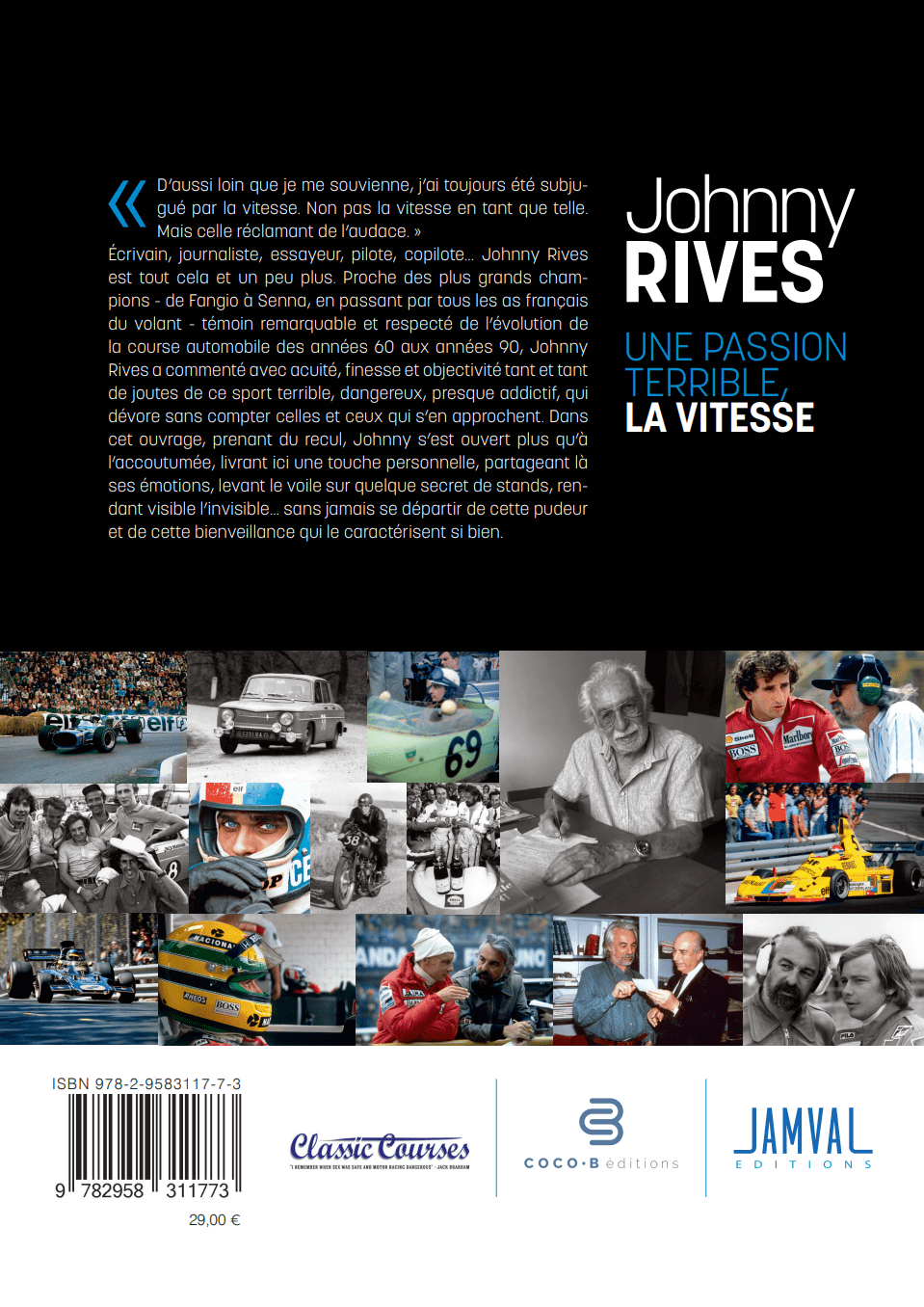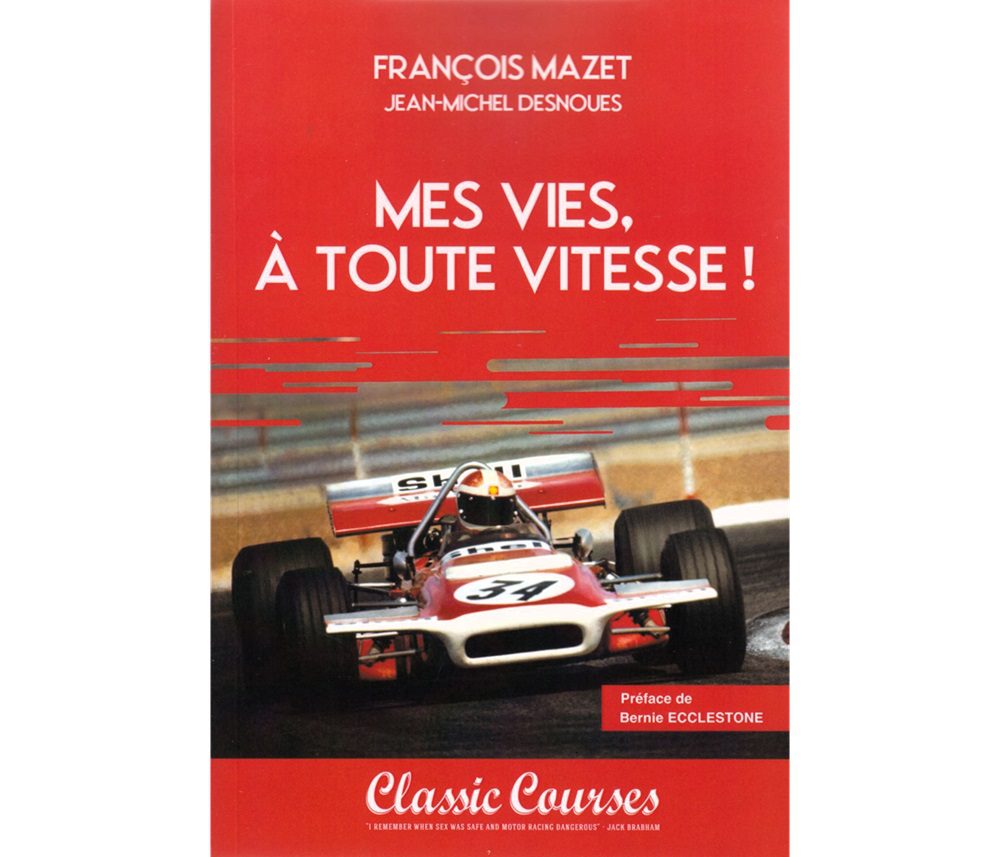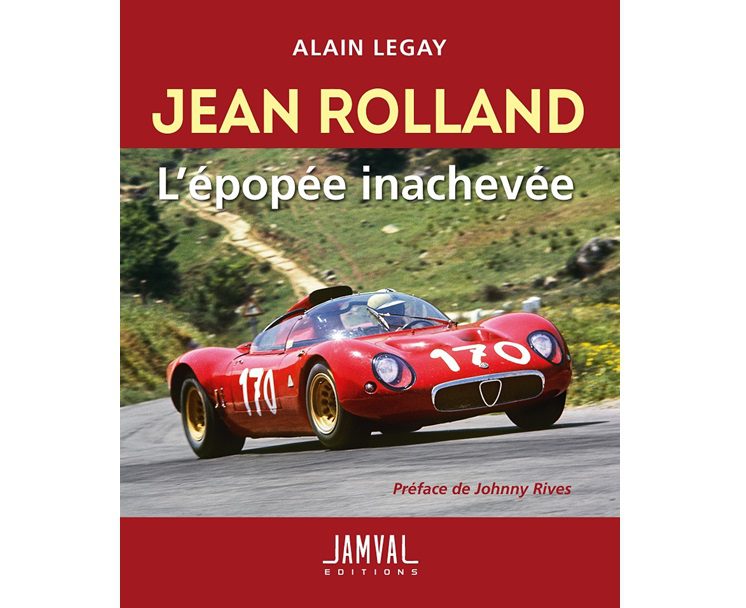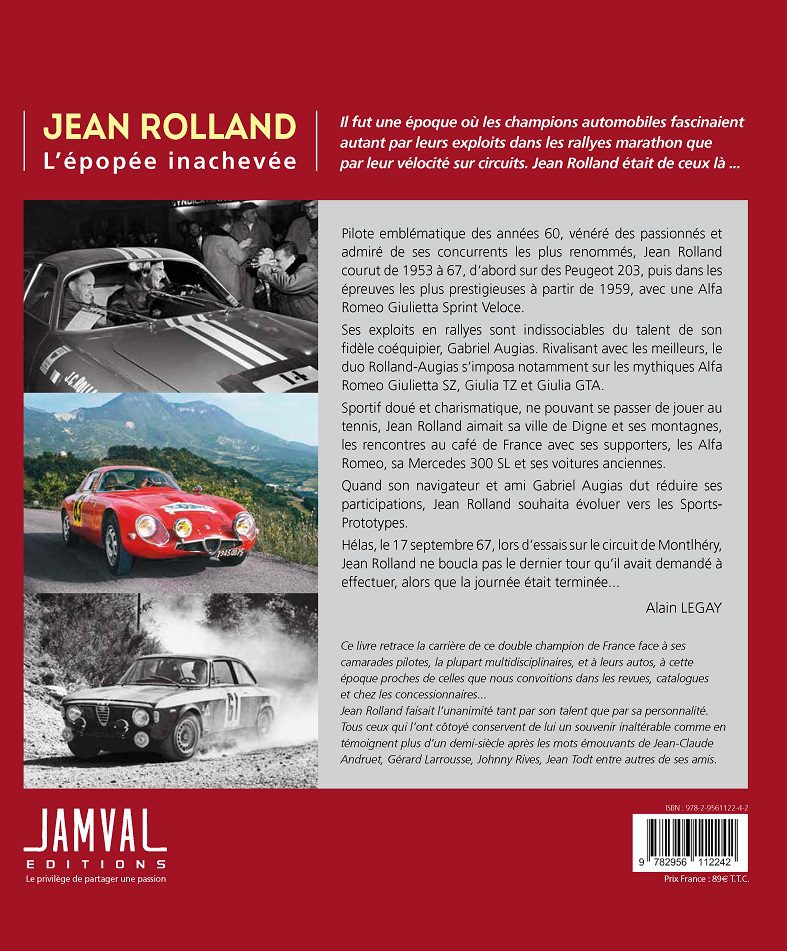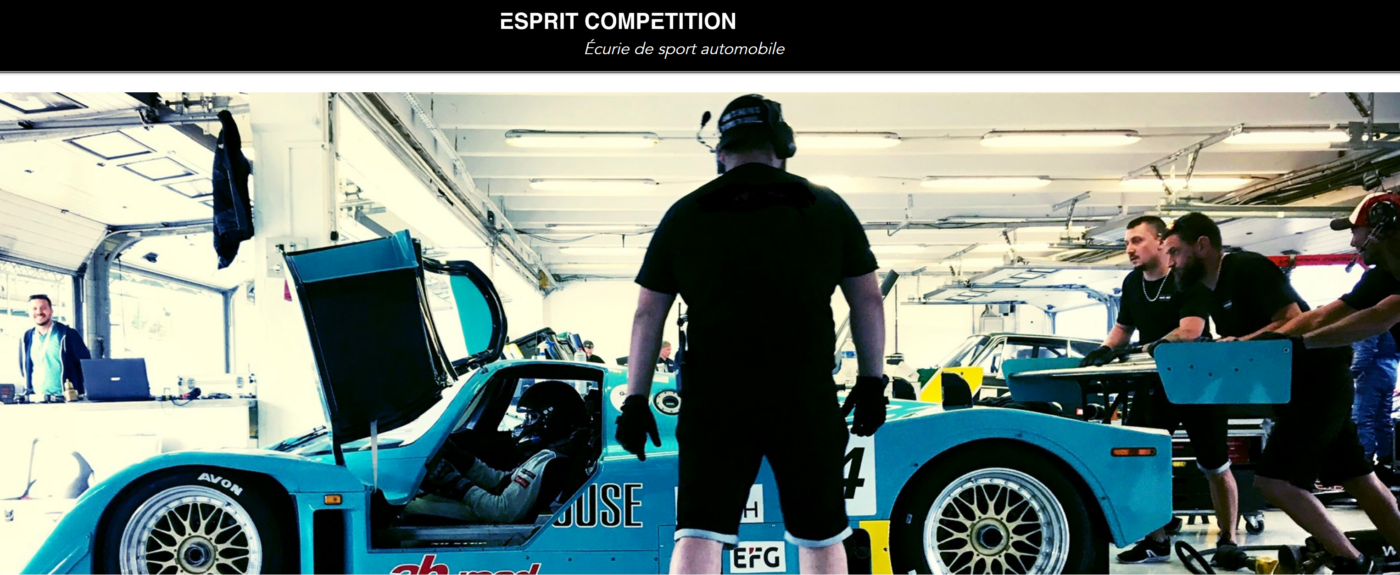Nous retrouvons le quadruple champion du monde pour évoquer avec lui ses années d’apprentissage de la monoplace, lors des interview qu’il nous a accordé en 2002. Il évoque ses rencontres, les bons moments… et les moins bons. Et parle avec conviction de la philosophie de la course que lui avait inculquée son sponsor, François Guiter : « Tu gagnes ton championnat, tu seras là l’année prochaine. Tu es deuxième, rien ne dit que tu y seras ».
Propos recueillis par Pierre Ménard
Publié le 7 avril 2015
Alain Prost, une vie, une carrière (1/4)
Alain Prost, une vie, une carrière (2/4)
Alain Prost, une vie, une carrière (3/4)
Alain Prost, une vie, une carrière (4/4)
1976-1979, FR, FRE et F3
PM : Parlez-moi de chez Jeannette à Saint-Parize. Ce sont de bons souvenirs ?
AP : Ça fait certainement partie de mes meilleurs souvenirs de ma carrière automobile. J’avais l’équipe qui était juste en face. Au début de 1976, je logeais dans une caravane, ensuite en Formule Renault Europe (FRE) en 77, je logeais dans un local en face de chez Jeannette. Il y avait une ambiance conviviale, un brassage de compétences intéressant. C’est le côté qu’on a perdu actuellement, je pense. Jeannette était pour nous une seconde mère. Mais c’était assez folklorique parce qu’en hiver, ce n’était pas chauffé et je me rappelle avoir dormi tout habillé certaines fois. Mais on était bien.
Quelles étaient vos relations avec Tico Martini ?
Je suis arrivé début au début de 1976 à Magny-Cours. Le prix du volant Elf me donnait deux choix : soit faire gérer mon budget par Elf ou quelqu’un d’autre, soit constituer ma propre équipe et la gérer moi-même. J’ai préféré prendre l’argent et gérer ma propre structure. Bernard Mangé préparait mes moteurs et Tico Martini nous fournissait les châssis. Et le mécanicien, Jean-Pierre Nicolas, conduisait le camion. De temps en temps on couchait à l’hôtel, mais le plus souvent on s’arrangeait pour dépenser le minimum. On formait un bon tandem avec Jean-Pierre, je lui demandais énormément de choses côté mécanique.

Avec Tico, on a eu des rapports un peu personnels, même si on ne se voyait pas énormément. Je crois que j’étais le seul à venir lui demander comment marchait la voiture et essayer de comprendre mieux. Il trouvait ça surprenant, mais bien. Du coup, dès qu’il y avait quelques chose à essayer, il me le proposait. C’était même avant que la saison commence. Dès le départ, j’ai compris qu’en étant 30 ou 40 en lice, il fallait faire la différence ailleurs que sur le coup de volant, parce qu’on n’est jamais sûr de rien. On a alors fait beaucoup d’essais pour comprendre la voiture, les pneus, et là je pense qu’on a vraiment progressé. J’ai beaucoup de respect pour Tico, c’est le genre de personne qui laisse son empreinte dans le sport automobile d’un pays. C’est un passionné, pour moi c’était déjà un sorcier. Je l’écoutais beaucoup.
A Dijon, lors de votre première course en FRE, étiez-vous conscient de l’émoi que vous avez causé dans le paddock avec votre pole d’enfer (1) ?
Oui, mais on ne peut pas généraliser. Vous avez ceux qui vous admirent, ceux qui « tombent de l’armoire », ceux qui ne savent pas quoi penser, et ceux qui pensent qu’il y a du louche. Mais ce dont je me rappelle, c’était du gros mécontentement de certains. La Lola était, il est vrai, super sur ce tracé, mais je n’étais pas le seul à l’avoir, attention ! Cudini en pilotait une, Bousquet aussi, et quinze jours après, j’étais quand même en première ligne avec à Zolder ! La même voiture. Par contre, j’ai fait une connerie en course, je n’aurais pas pu gagner. Mais à Dijon, c’était incroyable, et ça a fait beaucoup pour ma notoriété. Quand vous êtes jeune et que vous arrivez comme ça dans la cour de grands, avec des gens comme Pironi qui ont deux ou trois ans d’expérience de plus que vous, ça marque.
Ce qui était aussi extraordinaire à l’époque, et que les gens ont un peu oublié, c’est que la Formule Renault Europe représentait la meilleure formule, peut-être même mieux que la Formule 3. Parce qu’il y avait une liberté totale de développement. Pas tant au niveau moteur qu’au niveau châssis et aérodynamique. On travaillait sur la largeur des voies, sur l’empattement, on avait des gueuses mobiles pour les transferts de masse, des capots avant différents suivant la rapidité des tracés. Une saison de FRE procurait cent fois plus de bagage technique que ce que possèdent actuellement les jeunes qui débarquent de la F3 en F1. Et le plateau était sacrément relevé ! Bousquet, Snobeck, Cudini, Coulon, Pironi, c’était pas un hasard. Donc, quand vous avez 21 ans, que vous débarquez, et que vous faites la pole, c’est dur pour eux. Le sentiment que j’ai éprouvé à ce moment-là était indescriptible. J’étais heureux parce que je me sentais fort. Pas la grosse tête, mais six mois après le « Volant », faire la pole de la première course de FRE au nez et à la barbe de gens pratiquement aux portes de la F1, c’est quand même sacrément satisfaisant !
Vous placiez ça au-dessus des trois victoires d’affilée que vous veniez d’obtenir dans le championnat national ?
Non, je pense toujours à la globalité des choses. Vous savez, vous me parlez de Dijon, mais je n’y songeais même plus à la limite. Ça venait en plus des trois victoires en Formule Renault. C’est ce qui est toujours important : gagner dans une formule, arriver dans une autre et gagner aussi, ou du moins, marquer son terrain comme je l’ai fait à Dijon, c’est ce qui compte. Tiens ! Je regardais l’autre jour Sébastien Loeb, rallyeman qui arrive en Formule France et qui est déjà très bon, même chose ! On en reparlera de ce gars-là ! (2)

A Pau en 77 sur le podium, vous avez quelques mots restés célèbres avec Marc Cerneau (« Vous êtes un petit monsieur – Vous en êtes un autre » !). Vous étiez réellement en colère ? (3)
Je ne me rappelle plus exactement le teneur du
dialogue entre nous, mais il faut savoir que j’étais en tête et que je me fais gêner par un retardataire. Bousquet passe de l’autre côté, il ne reste plus que deux tours et je ne peux plus le rattraper. Je finis donc second. En fait, à Cerneau qui me disait de me contenter de cette seconde place, je lui répondais : « Si je ne gagne pas ce championnat, je me retrouve à la maison ». Je ne pouvais pas perdre une victoire à cause de la maladresse de quelqu’un d’autre, je joue ma carrière. Cerneau, qui était un sponsor, ça ne le concernait pas comme problème. Avec tout le respect que je peux avoir pour lui, c’est un total problème d’incompréhension. Pour moi, ce n’était, ni plus ni moins, que de la survie.
François Guiter, qui a fait beaucoup pour le sport automobile français, me disait : « Tu gagnes ton championnat, tu es là l’année prochaine. Tu ne gagnes pas, tu n’as aucune certitude d’y être ». Je suis donc toujours parti pour gagner les championnats. A la fin de l’année, je gagne avec deux ou trois points d’avance. Si je termine deuxième du championnat, je ne suis plus là. Vous ne pouvez pas réagir normalement quand vous êtes un champion. Des gens qui ont un bon coup de volant, il y en a des milliers. Ceux qui réussissent se comptent sur les doigts de la main. Il faut donc malheureusement accepter certains comportements de la part de champions, comportements qui viennent du fond du cœur plutôt que d’états d’âme. Quand les gens disent : « Il est mauvais perdant », ils ne comprennent pas ce que ça implique. Tous les gens comme moi ressentent ça, et je me retrouvais complètement avec Ayrton de ce côté-là. On est des gagneurs, on n’accepte pas de perdre d’une telle manière. Si je finis deuxième ou troisième et qu’il n’y avait rien à faire, vous ne me verrez jamais faire la tronche.

En 77, la bagarre a été rude avec Bousquet et Snobeck. Qui craigniez-vous le plus ?
Bousquet. C’était mon adversaire direct, et je le considérais comme un super pilote. J’aime beaucoup Danny. Sur certains circuits certains jours, comme à Monaco en 77, il était intouchable. J’ai essayé d’attaquer, mais rien n’y a fait. Sur deux ou trois courses, il était très fort. Mais il était moins régulier que Bousquet.
1978-1979 FORMULE 3
Vous étiez, je crois, très déçu de ne pas vous retrouver en F2 pour 1978 quand François Guiter vous a proposé le programme en F3. Qu’est-ce qui vous a finalement convaincu, le fait de n’avoir de toute façon rien d’autre ou l’organisation de Hugues de Chaunac ?
C’est de continuer dans le giron de Elf, et indirectement de Renault, qui m’a convaincu. Le moteur était un moteur officiel et, quelque part, je faisais un pari pour l’avenir. De Chaunac, bien sûr, mais c’était pas Hugues de Chaunac qui allait me mettre en F1. Je voulais avant tout suivre la voie Renault-Elf.
Vous partiez vraiment de loin face à la concurrence, notamment face au moteur Toyota…
Ah, on savait que ça allait être très dur. 78 était pour moi une saison d’apprentissage. J’ai juste gagné à la fin, Vallelunga, je crois [Non, Jarama, NDLA]. Le moteur se développait petit à petit. Là, c’était pareil : j’avais très peur durant la saison. Je voyais les avantages et les inconvénients d’être dans le giron d’un grand constructeur : comme un pilote ne reconnaîtra pas qu’il est moins bon, un constructeur ne pourra pas avouer que le moteur marche moins bien. Vous ne pouvez pas l’empêcher, c’est une question de fierté. Et je me disais que le moteur pouvait ne pas se développer, que tout pouvait s’arrêter fin 78, tout était possible venant d’un constructeur. Sauf quand les programmes sont fixés sur quatre ou cinq ans – et encore ! – on peut tout imaginer.
Vous rencontrez Nelson Piquet en F3 en 1978. Vous avez discuté un peu, appris à vous connaître ou pas ?
Je l’ai connu pour la première fois en 78 au Castelet, et on a sympathisé comme deux adversaires qui gagnent chacun de leur côté. Lui faisait le championnat anglais, puis est vite passé à la F 1. Je l’ai revu après en F1, et on a toujours eu des atomes crochus. Il parlait mal anglais, mais moi-aussi je baragouinais. C’est peut-être comme ça qu’on a accroché, on n’a pas besoin de se dire beaucoup de choses. C’est en F1 qu’on a appris à se connaître mieux et avec lui, je n’ai jamais eu le moindre problème. On était assez proche. Sur la piste, on était ennemi, mais par contre en dehors, ce qui était bien, c’est que Nelson ne parlait pratiquement pas de course. On s’entendait bien, on rigolait, alors qu’on ne se ressemble pas tellement. Je suis allé sur son bateau, on se retrouvait de temps en temps, on sortait le soir ensemble. C’était, et c’est toujours, un très bon copain.

Apparemment, vous vous entendiez bien avec Schlesser, Dallest ou Gaillard. Vous souvenez-vous de bonnes blagues que vous ayez faites, ou subies ?
En 78-79, on a effectivement passé de bons moments, bien qu’en 78 c’était un peu plus dur vu le travail de mise au point qu’on avait sur les bras. Mais en 79, avec Dallest et Métrébian, on avait une équipe à trois. Métrébian était une sorte de gentleman driver. A Zandvoort en 79, ils m’avaient enfermé dans ma chambre. J’ai été obligé de péter la baie vitrée pour aller aux essais officiels, vous voyez le niveau de la blague ! On n’arrêtait pas, c’était une bonne ambiance. C’était l’époque où on pouvait bien déconner le soir. Plus qu’en FR, c’était un championnat international et on se retrouvait entre Français, à deux ou à trois, et on se serrait les coudes.
Vous qui aviez une réputation de super metteur au point question châssis, vous vous intéressiez plus au châssis qu’au moteur à l’époque ?
Alors ça, j’ai lu ça deux ou trois fois dans les journaux, mais je crois sincèrement que ça fait partie d’une légende. Bon, j’étais très pointu question châssis, c’est vrai, mais c’est pas pour ça que je ne m’intéressais pas au moteur. Pour moi, la façon dont on peut travailler, notamment le frein-moteur, ça fait partie intégrante du châssis. Pour revenir en 78, je travaillais avec Bernard Dudot, mais surtout avec Serge Massé. Or, en terme de développement, quand vous demandez une modification à une équipe de F1, vous l’avez dans la semaine, voire les quinze jours qui suivent. En F3, ça peut prendre trois mois ! C’est pour ça qu’on évitait de trop toucher au moteur. Dans l’année, on a dû avoir deux développements, c’est tout. Quand vous touchez au réglage du châssis, le résultat est immédiat.

Votre victoire à Monaco en 79 frappe les esprits. Avez-vous été contacté par les team-managers de la F1 présents ?
Contrairement à ce qui a pu être dit, non. Plus tard, oui, mais sur le moment, non. J’imaginais, un peu naïvement, que les gens allaient regarder, mais c’est faux. Je ne suis pas sûr que les gens de la F1 regardent la course de F3 à Monaco. D’ailleurs, combien de pilotes vainqueurs à Monaco en F3 sont en F1 ? A mon avis, on doit les compter sur les doigts de la main, et encore… Ce qui s’est réellement passé – et encore une fois c’est un ensemble, pas un fait isolé qui produit le déclic – c’est que j’avais gagné beaucoup de courses, dont Monaco. Et là, avec Guiter, on s’est mis à penser à l’avenir : F2 ou F1 ? La F2, ça coûtait vraiment plus cher que la F3, et Elf n’était pas vraiment en F2. A l’époque, je crois qu’on demandait entre 1,5 et 2 millions de francs pour une saison de F2. Pour moi, Elf pouvait aller jusqu’à 500 000 francs, à peu près de cet ordre-là. Donc, Guiter m’a emmené en Amérique pour les deux derniers Grands Prix de F1.
(1) En mai 1976, Alain Prost a remporté sans coup férir ses trois premières courses en Formule Renault (il remportera 12 des 13 épreuves au programme !). Il a tellement impressionné la concurrence et la presse que Elf lui propose de se tester au plus haut niveau, et l’invite à disputer une course de Formule Renault Europe sur le difficile circuit de Dijon-Prenois face aux références de la catégorie. A la stupéfaction générale, il se permet de signer la pole-position (sans se faire aspirer, en plus) et provoque de sérieux grincements de dents parmi les cadors du paddock. Le lendemain, il ne perdra la course que sur un ennui mécanique (fuite d’huile), mais sa réputation naissante sera grandement renforcée par cet exploit atypique.
(2) rappelons-nous : nous sommes en avril 2002 au moment de cet interview et on peut dire qu’Alain Prost a eu le bon œil à propos de Loeb.
(3) A Pau en mai 1977, Prost mène la course de FRE avec Bousquet sur ses talons. Ils arrivent sur un retardataire – Gianbruno Del Fante – qui, surpris, fait un écart au dernier moment, envoyant la Martini de Prost en toupie. Bousquet réussi à se faufiler et à éviter l’accrochage, et Prost repart la rage au ventre. Il ne reste plus que deux tours, et il ne pourra pas rattraper Bousquet. Sur le podium où Alain tire la tronche des mauvais jours, Marc Cerneau lui reproche vertement d’être mauvais perdant et l’altercation verbale suit.